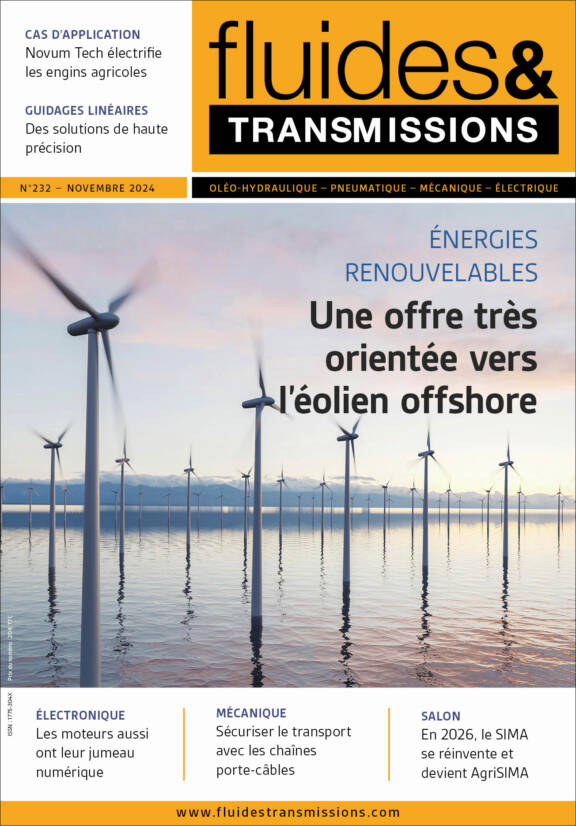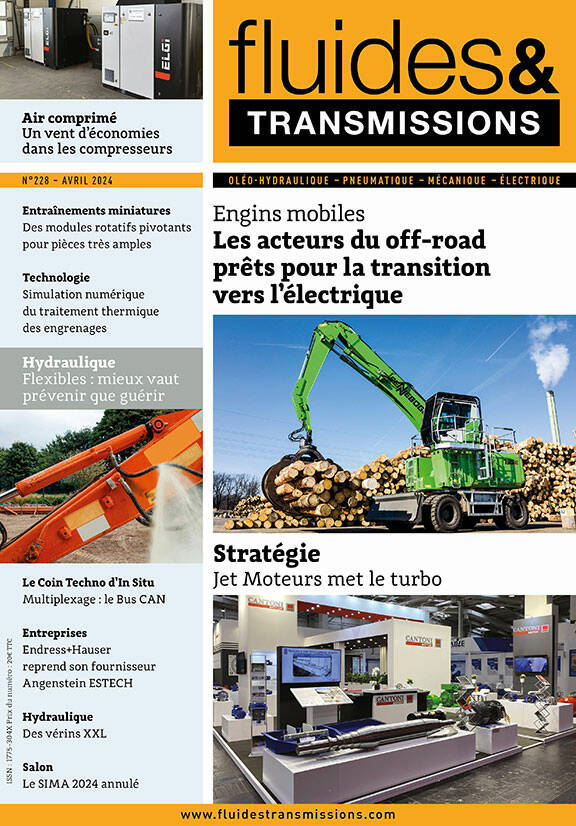Toutes les publications de la revue Fluides & Transmissions
-
N°235 - Avril 2025
La transmission de puissance au cœur des machines-outils
Les machines-outils sont au cœur de la production industrielle, et leur performance repose en grande partie sur les composants de transmission de puissance. Moteurs, variateurs, contrôleurs, engrenages et vérins forment un écosystème essentiel pour concilier puissance, efficacité et économies d’énergie. Ces éléments, bien que souvent discrets, sont déterminants pour répondre aux enjeux actuels de l’industrie. Dans le cas des centres d’usinage CNC, les moteurs synchrones, couplés à des variateurs de vitesse de haute précision, permettent des mouvements rapides et précis, réduisant les temps de cycle tout en optimisant la consommation électrique. Les engrenages, quant à eux, jouent un rôle clé dans la transmission de la puissance mécanique en limitant les pertes d’énergie, ce qui améliore l’efficacité globale de la machine. Dans les presses industrielles, les vérins hydrauliques ou électriques illustrent parfaitement l’équilibre entre puissance et sobriété énergétique. Grâce à des contrôleurs intelligents, ces systèmes ajustent la force en temps réel, évitant le gaspillage d’énergie tout en maintenant une productivité élevée. De même, dans les tours automatiques, l’intégration de moteurs à haut rendement et de variateurs permet de réduire la consommation électrique tout en augmentant la précision des opérations. Dans un contexte où la transition énergétique est devenue une priorité, ces composants offrent une réponse concrète aux défis industriels. Ils permettent non seulement de réduire les coûts opérationnels, mais aussi de minimiser l’impact environnemental des machines-outils. Investir dans ces technologies améliore la compétitivité. Les composants de transmission de puissance sont les leviers de cette révolution industrielle.Karim Boudehane, Rédacteur en chef
Accès au sommaireDossier - Stratégie - Solution - Technologie - Formation -
N°234 - Février/mars 2025
Hygiène : une priorité absolue
Moteurs, réducteurs, courroies et engrenages : la transmission de puissance contribue très largement au secteur agroalimentaire. Nos métiers ont amélioré significativement les performances des équipements. Les moteurs électriques à haut rendement, les variateurs de vitesse et les systèmes de contrôle intelligents permettent aujourd’hui une gestion précise et efficace des processus de production. Ces avancées se traduisent par une réduction des temps d’arrêt, une optimisation des coûts énergétiques et une amélioration de la productivité globale.
Mais la préoccupation première demeure l’hygiène. Les normes sanitaires strictes imposées par les réglementations européennes et françaises exigent des équipements capables de fonctionner dans des environnements propres et stériles. La transmission de puissance doit donc répondre à des critères spécifiques pour éviter toute contamination.
Les composants de transmission de puissance conçus pour l’industrie agroalimentaire doivent résister à la corrosion, être faciles à nettoyer. Les joints et les revêtements spéciaux empêchent l’accumulation de bactéries et facilitent les opérations de nettoyage. De plus, les systèmes de transmission sans lubrification ou avec des lubrifiants alimentaires approuvés réduisent les risques de contamination.
En outre, les fabricants développent des solutions comme les moteurs et réducteurs étanches, les courroies en matériaux compatibles avec les normes alimentaires et les systèmes de surveillance en temps réel.
L’autre impératif est en effet la fiabilité des équipements, enjeu crucial. Les arrêts de production imprévus peuvent entraîner des pertes financières importantes et compromettre la qualité des produits. La transmission de puissance doit donc être conçue pour offrir une durabilité et une performance constantes.
Les moteurs à aimants permanents, par exemple, offrent une meilleure efficacité énergétique et une plus grande longévité. Les systèmes de transmission modulaires permettent des réparations rapides et des mises à niveau faciles, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
La maintenance prédictive, rendue possible par les capteurs et les systèmes de contrôle intelligents, joue également son rôle clé. En surveillant en temps réel les paramètres de fonctionnement des équipements, les industriels peuvent anticiper les pannes et planifier les interventions de maintenance de manière proactive.Karim Boudehane, Rédacteur en chef
Accès au sommaireDossier - Stratégie - Solution - Technologie - Formation -
N°233 - Décembre 2024
L’étanchéité a retrouvé des couleurs
À environ 900 millions d’euros, l’étanchéité a retrouvé des couleurs depuis la funeste année 2020 : la profession a même largement dépassé son niveau de 2019 avec un indice de 114,3 contre 106,3 en 2019, selon ARTEMA, le syndicat de la mécatronique. L’étanchéité des circuits de transmission de puissance a toute sa place au sein de l’organisation professionnelle, pour de multiples raisons : parce que le fluide utilisé, qu’il s’agisse d’huile ou d’air comprimé, coûte cher et que la moindre fuite, pour insensible qu’elle puisse apparaître, peut se révéler très coûteuse. Ensuite pour des raisons de propreté et de respect de l’environnement de la machine. Enfin, parce que du choix de l’étanchéité en amont dépendra le bon fonctionnement du circuit et de l’ensemble de la machine. Les besoins sont très variables. Difficile d’en dresser une liste ici. Citons pour exemple la construction des vérins, pour lesquels il est nécessaire de proposer des solutions d’étanchéité statique et dynamiques. En général, des joints toriques suffisent pour assurer les étanchéités statiques. Pour assurer l’étanchéité dynamique, chaque constructeur propose des solutions qui lui sont propres. Une bonne définition des besoins est donc essentielle pour déboucher sur la conception et la mise en œuvre du système d’étanchéité le plus approprié à un équipement et à un domaine d’activités donnés. Les critères d’usure, de résistance physique et chimique, d’adéquation aux normes en vigueur et de facilité de maintenance, pour n’en citer que quelques-uns, doivent être soigneusement étudiés avant toute prise de décision. Car, si l’on est facilement tenté de n’accorder qu’une attention toute relative à des composants tels qu’un joint ou un tuyau, il faut toujours garder à l’esprit que les performances de toute la chaîne de production dépendent en grande partie de la qualité et de la technicité de ces derniers. Simples en apparence, les joints d’étanchéité, raccords et flexibles sont des éléments dont la technicité se révèle la plupart du temps très pointue. Une pièce d’apparence mineure peut entraîner le blocage d’un équipement de plusieurs millions d’euros. Le coût d’un système d’étanchéité doit donc toujours être mis en rapport avec celui de la machine et surtout avec les pertes induites par un arrêt de celle-ci. Dans tous les cas, le retour sur investissement sera rapide.
Karim BOUDEHANE, Rédacteur en chef
Accès au sommaireDossier - Stratégie - Solution - Technologie - Formation -
N°232 - Novembre 2024
Énergies renouvelables : le dilemme de leur diffusion optimale
Produits à la durée de vie plus longue, meilleurs rendements, l’offre des fabricants de composants à destination du secteur des énergies renouvelables est soumise à une contrainte majeure : réduire le coût du mégawatt. Le chemin est long et semé d’embûches : le politique a en effet la main sur ce type d’énergie. Des politiques spécifiques sont élaborées pour inciter à la fois à l’innovation et à la diffusion de ces technologies. D’un côté, le financement public de la R&D par les incitations fiscales (crédits d’impôts recherche) ou financières (subventions, prêts à taux zéro) qui vise à soutenir l’innovation dans les nouvelles technologies. Et de l’autre, des politiques de soutien à la diffusion qui visent à assurer leur déploiement et sont classiquement organisées en deux catégories : les politiques basées sur les prix et les politiques basées sur les quantités. Dans la première catégorie, les tarifs d’achat garantis (FIT pour Feed In Tariff) et les dispositifs de primes ont pour objectif d’inciter les agents à investir dans de nouvelles capacités de production, en garantissant un prix de rachat qui assure la rentabilité des investissements dans un cadre stable et prévisible. Dans la seconde, les politiques basées sur les quantités fixent des objectifs d’intégration des ENR dans le mix énergétique et s’appuient sur des systèmes d’enchères ou des dispositifs de flexibilité tels que les certificats verts. Le prix de l’électricité constitue un indicateur de la rentabilité attendue des investissements en innovation car un investissement dans la technologie génèrera d’autant plus de revenus que le prix de l’électricité est élevé. C’est là que le bât blesse pour les ménages comme pour les entreprises : les énergies renouvelables ont un coût. Plus l’innovation est favorisée, plus ce coût est élevé.Karim BOUDEHANE, Rédacteur en chef
Accès au sommaireDossier - Solution - Technologie - Formation -
N°231 - Octobre 2024
La sécurité, moteur de la transmission de puissance
Le marché de la transmission de puissance, qu’il s’agisse de mécanismes hydrauliques, pneumatiques ou électriques, requiert une précision et une fiabilité accrues pour satisfaire aux besoins croissants des industries. Mais cette quête de performance ne peut se faire au détriment de la sécurité. L’intégration croissante des technologies de l’Internet des objets (IoT), de l’intelligence artificielle (IA) et de l’automatisation rend les systèmes plus vulnérables aux défaillances techniques et aux cyberattaques. Dès lors, les systèmes de sécurité ne sont plus perçus comme un simple moyen de protéger les actifs, mais comme des leviers essentiels pour garantir la performance.
Les dispositifs de sécurité permettent de protéger les opérateurs et les infrastructures contre les risques physiques liés aux défaillances mécaniques. Au sein des chaînes de production, des infrastructures de transport ou des installations énergétiques, les conséquences d’un dysfonctionnement peuvent être désastreuses. Les systèmes de surveillance prédictive et les solutions automatisées de détection des anomalies permettent de prévenir ces incidents, améliorant la continuité des opérations et réduisant les coûts de maintenance.
En outre, les réglementations nationales et internationales se durcissent, poussant les entreprises à adopter des normes de sécurité de plus en plus strictes. Celles qui sauront anticiper et intégrer ces exigences réglementaires se positionneront en tête d’un marché de plus en plus compétitif. En investissant dès aujourd’hui dans des systèmes sûrs et certifiés, les entreprises se prémunissent contre d’éventuels retards ou surcoûts liés à des mises à niveau imposées par la législation.
Loin de ralentir l’innovation, les systèmes de sécurité sont désormais perçus comme des catalyseurs de croissance pour le marché de la transmission de puissance. À l’heure où l’industrie 4.0 et l’automatisation se généralisent, la maîtrise de la sécurité, tant physique que numérique, est devenue un impératif.Karim BOUDEHANE, Rédacteur en chef
Accès au sommaireDossier - Solution - Technologie - Formation -
N°230 - Septembre 2024
Bilan positif, perspectives mitigées
Dans un contexte de récession et de défaillances d’entreprises, les métiers de la transmission de puissance semblent tirer leur épingle du jeu. La question est : pour combien de temps ? ARTEMA, notre partenaire, indique dans le bilan annuel que nous préparons ensemble une hausse du chiffre d’affaires de 5 % en 2023 par rapport à 2022. Le rattrapage post-Covid est terminé, les retards de livraison se résorbent, nous retrouvons des niveaux plus conventionnels. À 8,8 milliards d’euros de CA (contre 8,4 milliards en 2022), la progression « correspond à la fourchette haute de nos anticipations, indique Laurence Chérillat, déléguée générale d’ARTEMA. L’effet prix y contribue, mais dans une bien moindre mesure que l’année précédente. » Selon l’INSEE, la progression en en volume est de l’ordre de 2,5 %. Ce qui est pris n’étant plus à prendre, les industriels peuvent s’en réjouir, sans perdre de vue quelques ombres au tableau : les carnets de commande se sont vidés du trop plein de 2022 durant le premier semestre de 2023. La décélération progressive a démarré en juin 2023. Ils tardent à se remplir à nouveau. Côté prix de l’énergie (électricité essentiellement), les tarifs pratiqués sont bien redescendus. Pour autant, ils demeurent supérieurs à ce qu’ils étaient avant le Covid. Un autre sujet d’inquiétude vient du cuivre, dont le prix continue d’augmenter, électrification oblige. La demande reste très forte : le cuivre reste le meilleur conducteur et le plus facile à travailler. Hausse prévue à fin 2024 : de l’ordre de 20 %. À surveiller : les défaillances, reparties à un rythme équivalent à celui d’avant la crise sanitaire, depuis la fin des prêts de l’État. L’ensemble conduit à des perspectives mitigées : les anticipations pour 2024 sont orientées à la baisse, entre 0 et – 3 %.Karim BOUDEHANE, Rédacteur en chef
Accès au sommaireConjoncture - Stratégie - Solution - Technologie - Formation -
N°229 - Mai/juin 2024
La révolution silencieuse
La maintenance prédictive avance et transforme radicalement la façon dont l'industrie opère. Elle repose sur l'utilisation de données et d'analyses avancées pour prévoir les défaillances des équipements avant que celles-ci ne se produisent. Contrairement à la maintenance préventive traditionnelle, qui repose sur des calendriers fixes ou des seuils d'usure, la maintenance prédictive prend en compte les conditions réelles de fonctionnement des machines. En utilisant des capteurs intelligents, des algorithmes d'apprentissage automatique et des systèmes d'analyse de données sophistiqués, les entreprises surveillent désormais en temps réel l'état de leurs équipements et détectent les signes avant-coureurs de défaillance. Ses avantages sont nombreux et significatifs : réduction des temps d'arrêt imprévus en identifiant les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent critiques. Cela permet aux entreprises d'optimiser la disponibilité de leurs équipements et d'éviter les pertes de production coûteuses. En outre, en planifiant les interventions de maintenance de manière proactive, les entreprises peuvent réduire les coûts de main-d'œuvre et de pièces de rechange, tout en prolongeant la durée de vie utile de leurs équipements.
Mais les avantages de la maintenance prédictive vont bien au-delà de la simple réduction des coûts et de l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. En permettant aux entreprises de prévoir les défaillances des équipements, elle contribue également à renforcer la sécurité des travailleurs et à réduire les risques d'accidents. En détectant les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent des menaces pour la sécurité, la maintenance prédictive aide à créer des environnements de travail plus sûrs et plus fiables. La maintenance prédictive ouvre en outre la voie à de nouveaux modèles d'affaires et de services. En offrant des solutions de surveillance et de maintenance prédictive en tant que service, les entreprises peuvent développer de nouvelles sources de revenus récurrentes et renforcer leurs relations avec leurs clients. De même, en combinant la maintenance prédictive avec d'autres technologies émergentes telles que l'Internet des objets (IoT) et l'intelligence artificielle (IA), les entreprises peuvent créer des écosystèmes technologiques complets qui transforment radicalement la façon dont les produits sont conçus, fabriqués et entretenus. Une mise en œuvre réussie ne se fait pas sans difficultés ni investissements. La maintenance prédictive nécessite des investissements importants dans les technologies de capteurs, d'analyse de données et d'infrastructure informatique, ainsi que des compétences techniques avancées pour interpréter et utiliser efficacement les données générées.
De plus, elle exige souvent un changement culturel au sein des organisations, avec une transition de la réactivité à la proactivité en matière de maintenance. Pour autant, son adoption est en plein essor. Les entreprises qui investissent dans ces technologies voient des retours sur investissement significatifs sous forme de réduction des coûts, d'amélioration de la productivité et de renforcement de la compétitivité. La maintenance prédictive se positionne comme l'une des pierres angulaires de la transformation numérique, ouvrant la voie à une efficacité opérationnelle accrue, à une sécurité renforcée et à une innovation continue.Karim BOUDEHANE, Rédacteur en chef
Accès au sommaireDossier - Solution - Formation -
N°228 - Avril 2024
Électrique, hydraulique ou hybride ?
Dans le monde de l'off-road, le choix de la transmission est crucial. Les transmissions électriques, hydrauliques et hybrides ont émergé comme des alternatives prometteuses, complémentaires, plutôt qu’opposées. Chaque option offre ses avantages et ses défis.
La transmission électrique offre un couple instantané et une puissance constante, ce qui se traduit par des performances impressionnantes sur terrains difficiles. De plus, elle est plus silencieuse que ses homologues, réduisant ainsi la pollution sonore souvent associée aux véhicules tout-terrain. Cependant, la portée limitée et le temps de recharge des batteries demeurent des obstacles à surmonter pour un usage prolongé.
Côté hydraulique, les utilisateurs louent souvent la robustesse et la fiabilité exceptionnelles des engins, en conditions extrêmes. Le mode hydraulique peut offrir un couple élevé à bas régime, idéal pour les situations de traction difficiles. De plus, la transmission hydraulique est moins sensible aux dommages causés par les chocs et les vibrations, ce qui en fait un choix idéal dans les environnements hostiles. Cependant, sa complexité mécanique et sa sensibilité aux fuites peuvent nécessiter un entretien plus fréquent et une expertise technique plus poussée.
Face à ces deux options distinctes, la transmission hybride émerge comme un compromis astucieux entre performance et durabilité. En combinant les avantages des transmissions électriques et hydrauliques, cette méthode offre une polyvalence inégalée sur une variété de terrains. En utilisant un moteur électrique pour la propulsion principale et un système hydraulique pour une assistance supplémentaire, le mode hybride peut maximiser l'efficacité énergétique tout en offrant une puissance et une résistance exceptionnelles. De plus, la récupération d'énergie lors du freinage peut prolonger l'autonomie et réduire la dépendance à l'égard des sources d'énergie externes.
Le choix entre la transmission électrique, hydraulique et hybride dépendra finalement des préférences individuelles, des exigences de performance et des conditions d'utilisation. Tandis que certains privilégient la simplicité et l'efficacité de l'électrique, d'autres opteront pour la robustesse et la fiabilité de l'hydraulique. Pour ceux qui cherchent le meilleur des deux mondes, la transmission hybride représente une solution innovante qui repousse les limites de ce qui est possible en matière d'off-road.Karim BOUDEHANE, Rédacteur en chef
Accès au sommaireDossier - Stratégie - Solution - Technologie - Formation -
N°227 - Février-mars 2024
Investissez dans la performance
L’efficacité opérationnelle dans le domaine industriel repose sur des composants en parfait état de fonctionnement. Deux éléments cruciaux dans ce contexte sont souvent sous-estimés, mais essentiels pour assurer la longévité des équipements et la qualité des processus : la filtration de l’huile hydraulique et le maintien en propreté de l’air comprimé.
La cause principale de défaillance d’un circuit hydraulique est la présence de particules libres circulant dans le fluide hydraulique. Des particules générées par les opérations de maintenance ou de construction des réseaux hydrauliques (silice, fibres textiles, limaille) soit par la destruction d’un organe de fonctionnement tels que les pompes ou les vannes.
La dépollution hydraulique consiste à éliminer les polluants par circulation à grande vitesse en circuit fermé dans les réseaux au travers de filtres dont le seuil de filtration est établi par la classe de propreté requise.
De même, le maintien en propreté de l’air comprimé représente un aspect souvent négligé mais crucial dans de nombreuses industries. L’air comprimé est utilisé dans une variété d’applications, allant de l’automatisation des processus à la propulsion d’outils industriels. Cependant, l’air ambiant contient des impuretés sous forme de particules, d’humidité et de contaminants gazeux. Ces éléments peuvent entraîner des dysfonctionnements des équipements, réduire l’efficacité des processus et provoquer des dommages.
Investir dans des systèmes de filtration de qualité constitue un investissement dans la productivité et la durabilité à long terme. Les entreprises qui intègrent des solutions de filtration efficaces bénéficient d’une réduction significative des coûts de maintenance, d’une amélioration de la fiabilité opérationnelle et d’une prolongation de la durée de vie des équipements.
La filtration de l’huile hydraulique et le maintien en propreté de l’air comprimé ne représentent pas simplement des coûts, mais des piliers essentiels pour garantir des opérations fluides, fiables et durables. C’est un investissement dans la performance industrielle.Karim BOUDEHANE, Rédacteur en chef
Accès au sommaireDossier - Solution - Technologie - Formation -
N°226 - Décembre 2023
Moteurs électriques, un rendement avantageux
L’avantage principal des moteurs électriques est leur rendement énergétique. Contrairement aux moteurs traditionnels, ils convertissent l’énergie de manière plus directe, avec un minimum de pertes. La variation de vitesse enfonce le clou, et leur confère, de ce point de vue, une longueur d’avance.
Des progrès notables ont été réalisés dans le développement de batteries haute performance, augmentant l’autonomie des véhicules électriques tout en réduisant le temps de recharge. La miniaturisation des composants électroniques a également joué un rôle crucial dans l’amélioration de la compacité des moteurs électriques, les rendant plus adaptables à une variété d’applications.
Cette polyvalence accrue ouvre la voie à des solutions de mobilité innovantes.
Malgré ces avancées spectaculaires, des défis subsistent. L’infrastructure de recharge doit être développée de manière significative pour accompagner la croissance exponentielle des véhicules électriques, en particulier des engins mobiles off road. De plus, la dépendance aux matériaux rares pour la fabrication des batteries soulève des questions quant à la durabilité à long terme de cette révolution énergétique.
La question des coûts, souvent négligée, doit être abordée. Bien que les coûts de production diminuent progressivement, les véhicules électriques restent souvent plus onéreux à l’achat que leurs homologues à combustion interne. Sans les incitations financières et les subventions accordées, la mobilité électrique demeurent difficilement accessibles.
Les moteurs électriques représentent indéniablement une avancée dans la transmission de puissance, offrant des avantages en termes d’efficacité énergétique. Mais il est impératif de maintenir un équilibre réaliste entre le bénéfice attendu et une reconnaissance des défis inhérents à cette transition.Karim BOUDEHANE, Rédacteur en chef
Accès au sommaireDossier - Stratégie - Solution - Technologie - Formation